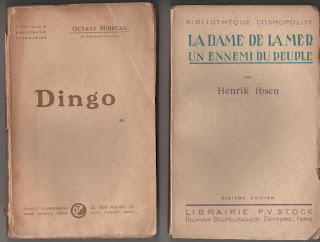Journal (1966-1974) de Jean-Patrick Manchette (Gallimard. 2008)
Nul n’ignore désormais que si j’aime m’imposer des règles et me conformer à des dogmes rigides, c’est pour mieux les transgresser ! Il en va de même avec cette bibliothèque idéale à laquelle je me suis attelé puisque je vais vous parler d’un livre qui n’y figure pas. Mais comme chaque catégorie ne comprend que 49 livres et que les auteurs ont pris soin de noter « à vous de choisir le cinquantième », je m’exécute et vous propose de nous pencher sur l’évènement littéraire du printemps 2008, à savoir la publication du copieux Journal de Jean-Patrick Manchette.
Personnellement, je suis un inconditionnel des mémoires et journaux intimes. Je me suis régalé avec le Journal de Léon Bloy et le premier volume de celui de Nabe (il faut absolument que je trouve les suivants) car on peut y découvrir à la fois le travail de l’écrivain et ses vicissitudes (la misère permanente de Bloy par exemple. Pour Manchette, c’est différent. Il a connu, au départ, quelques périodes de vaches maigres mais on le voit assez rapidement prendre son envol et avoir du succès) et un portrait en coupe de l’époque et de la manière dont une individualité la ressent.
C’est aussi l’occasion de pénétrer des univers qui demeurent, quant à moi, totalement inconnus (le monde de la presse et de l’édition chez Nabe, avec des portraits savoureux de l’équipe de Charlie-Hebdo, la série noire et le monde du cinéma chez Manchette).
En 1966, Manchette a 24 ans, il débute un journal intime qu’il poursuivra jusqu’à sa mort en 1995 (on a hâte de lire les volumes suivants !). Nous y suivons les débuts d’un jeune auteur talentueux, déjà père de famille et très amoureux de sa chère Mélissa, qui va commencer par de plus ou moins « viles » besognes (des « novellisations » de séries télévisées ou de films, un roman érotique, des collaborations scénaristiques pour des films de Max Pécas ou Jean-Pierre Bastid, de nombreuses traductions pour les « Presses de la cité »…) avant de percer dans le roman noir en compagnie de Bastid (Laissez bronzer les cadavres) puis en solo (L’affaire N’Gustro, Ô dingos, ô châteaux ! Nada…).
L’ascension de Manchette est absolument passionnante à suivre puisque l’on croise un certain nombre de personnalités. Côté littérature, on le voit rencontrer assez régulièrement A.D.G qui aimerait, justement, lancer une sorte de « mouvement » au sein de la Série Noire ou encore Guégan et Sorin qui lui proposent du boulot chez Champ Libre (on sait d’ailleurs, grâce à Guégan, que c’est Manchette qui trouvera le nom de la fameuse collection « Chute libre » de la maison d’édition).
Côté cinéma, c’est le défilé quand arrive le temps des adaptations de ses propres romans auxquelles il participe. On croise Bernadette Lafont et Marlène Jobert et l’on regrette que l’adaptation d’Ô dingos, ô chateaux ait finalement échoué aux mains du médiocre Yves Boisset alors que Mocky fut d’abord envisagé (Manchette n’arrêtant d’ailleurs pas de vitupérer contre les aménagements apportés par le cinéaste).
D’une manière générale, Manchette semble avoir beaucoup de distance par rapport à son travail pour le cinéma. Il écrit le plus grand mal des films auxquels il participe (le Socrate de Lajournade, le film jamais sorti de Bastid…) et n’a pas grande considération pour les œuvres des cinéastes avec qui il va travailler (Boisset, Valère, Grimblat…). Seul Chabrol échappe un peu à sa verve destructrice (il avoue son intérêt pour Que la bête meure et Les bonnes femmes) mais ça reste mitigé (l’adaptation de Nada ne lui convient qu’à moitié et il jubile lorsque la critique souligne la qualité du livre pour descendre le film ! Rétrospectivement, c’est pourtant –et de très loin- ce que Manchette a fait de mieux pour le cinéma et la télévision !)
Cette désinvolture vis-à-vis de son travail pour le cinéma (je parle en terme de résultats car c’est peu dire que l’écrivain s’implique dans ces projets et y travaille d’arrache-pied) s’explique sans doute par le grand dilemme « politique » de sa vie.
Intellectuellement, Manchette est très proche des situationnistes qu’il a parfaitement compris et dont il s’est indéniablement nourri pour son travail d’analyse du monde contemporain. Dans ce journal, il y a des réflexions d’une rare acuité sur les syndicats, le pouvoir et l’étendue de plus en plus vaste de l’économie « spectaculaire-marchande »… De la même manière, Manchette découpe et colle dans ses cahiers des articles de journaux les plus représentatifs de l’état de décomposition du monde. C’est souvent édifiant !
Le problème, c’est que cette conscience révolutionnaire se heurte à une volonté de vivre dans un certain confort et à la crainte de « tout perdre ». Il s’agit donc de travailler au cœur du système sans jamais en être dupe. Certains lui ont reproché cette attitude (Lebovici lui enverra une de ses célèbres lettre d’insultes et il sera mis à l’index par les « pro-situs ») mais il est notable que jamais Manchette ne sombrera dans le cynisme qui rattrapera la plupart des gens de sa génération. Il ne s’agit jamais de « profiter du système » mais de s’en servir pour préserver son indépendance et y introduire, pourquoi pas ?, une part de ce « négatif » qu’il appelle de ses vœux (ce sera le cas dans ses romans noirs qu’il faut lire absolument).
Pour Manchette, ce travail alimentaire lui permet de mettre sa famille à l’abri du besoin et de s’offrir du temps pour s’occuper de l’amour de sa vie (son journal regorge de très beaux passage sur sa « monogamie » qu’il oppose très justement à la « spectacularisation » de la liberté sexuelle qui fait du sexe un produit consommable comme les autres), des livres et des films.
Car si le Journal m’a tant plu, c’est que l’auteur de Morgue pleine y consigne les titres des livres lus et des films vus avec des commentaires plus ou moins longs. Et c’est peu dire qu’il fut un boulimique. Je rêve de pouvoir lire ses « notes de lectures » qu’il consignait visiblement sur un autre cahier. On notera aussi son éclectisme puisqu’il passe sans arrêt de textes théoriques (Hegel, Marx…) à des livres de SF ou de grands classiques (Renard, Lowry, Nabokov…). On soulignera aussi par l’anecdote son goût pour les livres édités chez Champ Libre (je crois qu’il a dévoré tout le catalogue) et l’ironie qui lui fait critiquer une préface virulente d’un certain Yvan Cloarec qui n’est autre que… Gérard Guégan qu’il rencontrera un peu plus tard.
Côté cinéma, on voit se développer une pensée qu’on retrouvera de manière plus développée dans ses somptueuses chroniques pour Charlie-Hebdo (regroupées dans le recueil Les yeux de la momie). Ici, les avis sont essentiellement lapidaires (« merdeux », « abject », « très mauvais »…) et certaines gloires sont étrillées pour notre plus grand plaisir (quand bien même on est d’un avis opposé !). Cédons au plaisir de quelques exemples gratinés :
Sur Dreyer et son Dies Irae, « horrible merde répressive. (…). La notion de péché imprègne tout le film, qui devient une sorte de roquefort théologique, strictement puant et inconsommable. Notre attention soutenue nous a permis quelques bonnes plaisanteries obscènes ou absurdes. Dreyer est un con. »
Sur Robbe-Grillet (oh oui ! encore !) : « Une bêtise élevée à ce niveau de sérieux et de charabia exerce une sorte de fascination. Ce n’est même plus un spectacle commercial, c’est le mouvement autonome du vide pour lui-même. (…). Robbe-Grillet est le zéro absolu… »
Sur César et Rosalie de Sautet : « Monstrueux (une imbécile hésite entre deux cons), ignoble (l’univers de l’argent et de la réification totale), scandaleux (Sautet sait filmer, c’est un talent au service de l’idéologie dominante dans ce qu’elle a de plus abject). »
Certains jugements à l’emporte-pièce laissent pantois (le « fasciste » accolé à Duel au soleil de King Vidor) mais c’est aussi la radicalité de Manchette qui nous le rend si cher. Et c’est cette radicalité qui rend passionnante la lecture de ce pavé de plus de 600 pages qu’on dévore sans le moindre ennui.
Vivement la suite !
Libellés : ADG, Bibliothèque idéale, Bloy, Champ libre, Charlie-Hebdo, Dreyer, Guégan, Journaux et carnets, Manchette, Nabe, Robbe-Grillet, Sautet